Ordre mondial multipolaire – Partie 1
Rédigé par Iain Davis via OffGuardian.org ,
La guerre de la Russie avec l'Ukraine est d'abord et avant tout une tragédie pour les peuples des deux pays, en particulier ceux qui vivent – et meurent – dans les zones de combat. La priorité pour l'humanité, mais apparemment pas pour la classe politique, est d'encourager Moscou et Kyiv à cesser de tuer des hommes, des femmes et des enfants et à négocier un accord de paix.
Au-delà des limites immédiates du conflit, la guerre est également considérée par certains comme représentative d'un prétendu affrontement entre grandes puissances et, peut-être, entre civilisations. Toutes les guerres sont capitales, mais les ramifications de la guerre ukrainienne sont déjà mondiales.
Par conséquent, il y a une perception qu'il est le point focal d'une confrontation entre deux modèles distincts de gouvernance mondiale. L'alliance des nations occidentales dirigée par l'OTAN continue de promouvoir l'ordre international unipolaire du G7 fondé sur des règles (IRBO). Il s'oppose, selon certains, aux BRICS dirigés par la Russie et la Chine et à l'ordre mondial multipolaire basé sur le G20.
Dans cette série en 3 parties, nous explorerons ces questions et examinerons s'il est tenable de placer notre foi dans l'ordre mondial multipolaire émergent.
Il y a très peu de caractéristiques rédemptrices de l'ordre mondial unipolaire, c'est certain. C'est un système qui sert massivement le capital et peu de personnes autres qu'une «classe parasite» d'eugénistes capitalistes parties prenantes. Cela a conduit de nombreux Occidentaux mécontents à placer leurs espoirs dans la promesse d'un ordre mondial multipolaire :
Beaucoup acceptent de plus en plus la réalité que le système multipolaire d'aujourd'hui dirigé par la Russie et la Chine repose sur la défense du droit international et de la souveraineté nationale, comme indiqué dans la Charte des Nations Unies. [. . .] Poutine et Xi Jinping ont [. . .] ont choisi de défendre la coopération gagnant-gagnant plutôt que la pensée hobbesienne à somme nulle. [. . .] [L]a totalité de leur stratégie repose sur la Charte des Nations Unies.
Si seulement c'était le cas ! Malheureusement, cela ne semble pas être le cas. Mais même si c'était vrai, Poutine et Xi Jinping basant "toute leur stratégie" sur la Charte des Nations Unies, serait une source d'inquiétude, pas de soulagement.
Pour les forces mondialistes qui voient les États-nations comme des cases sur le grand échiquier et qui considèrent des dirigeants comme Poutine, Biden et Xi Jinping comme des complices, l'ordre mondial multipolaire est une manne du ciel. Ils ont passé plus d'un siècle à essayer de centraliser le pouvoir mondial. Le pouvoir des États-nations individuels présente au moins la possibilité d'une certaine décentralisation. L'ordre mondial multipolaire met enfin fin à toute souveraineté nationale et délivre une véritable gouvernance mondiale.
Ordre mondial
Nous devons faire la distinction entre le concept idéologique d'« ordre mondial » et la réalité. Cela nous aidera à identifier où «l'ordre mondial» est une construction artificiellement imposée.
Le pouvoir autoritaire, exercé sur les populations, le territoire et les ressources, limité par la géographie physique et politique, dicte « l'ordre mondial ». L'ordre actuel est en grande partie le produit d'une géopolitique intransigeante, mais il reflète aussi les diverses tentatives d'imposer un ordre mondial.
La lutte pour gérer et atténuer les conséquences de la géopolitique est évidente dans l'histoire des relations internationales. Pendant près de 500 ans, les États-nations ont cherché à coexister en tant qu'entités souveraines. De nombreux systèmes ont été conçus pour prendre le contrôle de ce qui serait autrement l'anarchie. C'est au détriment de l'humanité que l'on n'a pas permis à l'anarchie de prospérer.
En 1648, les deux traités bilatéraux qui formaient la paix de Westphalie concluaient la guerre (ou les guerres) de 30 ans. Ces règlements négociés ont sans doute établi le précepte de la souveraineté territoriale à l'intérieur des frontières de l'État-nation.
Cela a réduit, mais n'a pas mis fin, au pouvoir autoritaire centralisé du Saint Empire romain germanique (HRE). Britannica note :
La paix de Westphalie a reconnu la pleine souveraineté territoriale des États membres de l'empire.
Ce n'est pas tout à fait exact. Cette soi-disant « pleine souveraineté territoriale » délimitait le pouvoir régional au sein de l'Europe et de l'EDH, mais la pleine souveraineté n'était pas établie.
Les traités westphaliens ont créé des centaines de principautés qui étaient autrefois contrôlées par la législature centrale de l'EDH, la Diète . Ces nouvelles principautés effectivement fédéralisées payaient toujours des impôts à l'empereur et, surtout, l'observance religieuse restait une question de décision de l'empire. Les traités ont également consolidé le pouvoir régional des États danois, suédois et français, mais l'Empire lui-même est resté intact et dominant.
Il est plus exact de dire que la paix de Westphalie a quelque peu restreint le pouvoir autoritaire de l'EDH et défini les frontières physiques de certains États-nations. Au XXe siècle, cela a conduit à l'interprétation populaire de l'État-nation comme un rempart contre le pouvoir hégémonique international, bien que cela n'ait jamais été tout à fait vrai.
Par conséquent, le soi-disant « modèle westphalien » repose en grande partie sur un mythe . Il représente une version idéalisée de l'ordre mondial, suggérant comment il pourrait fonctionner plutôt que décrivant comment il fonctionne.

Si les États-nations étaient vraiment souverains et si leur intégrité territoriale était véritablement respectée, alors l'ordre mondial westphalien serait une pure anarchie. C'est l'idéal sur lequel l'ONU est censée être fondée car, contrairement à un autre mythe populaire omniprésent, l'anarchie ne signifie pas «chaos». Plutôt l'inverse.
L'anarchie est illustrée par l'article 2.1 de la Charte des Nations Unies :
L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres.
Le mot « anarchie » est une abstraction du grec classique « anarkhos », qui signifie « sans règle ». Ceci est dérivé du préfixe privatif "an" (sans) en conjonction avec "arkhos" (chef ou dirigeant). Traduit littéralement, "anarchie" signifie "sans dirigeants" - ce que l'ONU appelle "l'égalité souveraine".
Un ordre mondial westphalien d'États-nations souverains, chacun observant «l'égalité» de tous les autres tout en adhérant au principe de non-agression , est un système d'anarchie politique mondiale. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que fonctionne « l'ordre mondial » actuel de l'ONU, et il n'y a jamais eu de tentative d'imposer un tel ordre. C'est dommage.
Au sein de la Société des Nations et du système d'« ordre mondial » pratique de l'ONU qui a suivi – un ordre mondial prétendument fondé sur la souveraineté des nations – l'égalité n'existe qu'en théorie. Grâce à l'empire, au colonialisme, au néocolonialisme, c'est-à-dire à la conquête économique, militaire, financière et monétaire, couplée aux obligations de dette imposées aux nations ciblées, les puissances mondiales ont toujours été en mesure de dominer et de contrôler les moindres.
Les gouvernements nationaux, s'ils sont définis en termes purement politiques, n'ont jamais été la seule source d'autorité derrière les efforts pour construire l'ordre mondial. Comme l'ont révélé Antony C. Sutton et d'autres, le pouvoir des entreprises privées a aidé les gouvernements nationaux à façonner «l'ordre mondial».
Ni la montée au pouvoir d' Hitler ni la révolution bolchevique n'auraient eu lieu comme elles l'ont fait, voire pas du tout, sans la direction des financiers de Wall Street. Les institutions financières mondiales des banquiers et les vastes réseaux d'espionnage internationaux ont joué un rôle déterminant dans le déplacement du pouvoir politique mondial.
Ces « partenaires » du secteur privé du gouvernement sont les « intervenants » dont nous entendons constamment parler aujourd'hui. Les plus puissants d'entre eux sont pleinement engagés dans « le jeu » décrit par Zbigniew Brzezinski dans Le Grand Échiquier .
Brzezinski a reconnu que la masse continentale de l'Eurasie était la clé d'une véritable hégémonie mondiale :
Cet immense échiquier eurasien aux formes étranges, qui s'étend de Lisbonne à Vladivostok, sert de cadre au « jeu ». [. . .] [S]i l'espace du milieu repousse l'Occident, devient une entité unique affirmée [. . .] alors la primauté de l'Amérique en Eurasie rétrécit dramatiquement. [. . .] Ce méga-continent est tout simplement trop vaste, trop peuplé, culturellement trop varié et composé de trop d'États historiquement ambitieux et politiquement énergiques pour se plier à la puissance mondiale la plus économiquement prospère et politiquement prééminente. [. . .] L'Ukraine, espace nouveau et important sur l'échiquier eurasien, est un pivot géopolitique car son existence même en tant que pays indépendant contribue à transformer la Russie. Sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire eurasien. [. . .] [I]l deviendrait alors un État impérial à prédominance asiatique.
L'« ordre mondial unipolaire » privilégié par les puissances occidentales, souvent appelé « ordre international fondé sur des règles » ou « système international fondé sur des règles », est une autre tentative d'imposer l'ordre. Ce modèle « unipolaire » permet aux États-Unis et à ses partenaires européens d'exploiter le système onusien pour revendiquer la légitimité de leurs jeux d'empire. À travers elle, l'alliance transatlantique a utilisé sa puissance économique, militaire et financière pour tenter d'établir une hégémonie mondiale.
En 2016, Stewart Patrick , écrivant pour le Council on Foreign Relations (CFR) des États-Unis, un groupe de réflexion sur la politique étrangère, a publié World Order: What, Exactly, are the Rules? Il a décrit « l'ordre international fondé sur des règles » (IRBO) après la Seconde Guerre mondiale :
Ce qui distingue l'ordre occidental d'après 1945, c'est qu'il a été façonné en très grande majorité par une seule puissance [une unipolarité], les États-Unis. Opérant dans le contexte plus large de la bipolarité stratégique, elle a construit, géré et défendu les régimes de l'économie mondiale capitaliste. [. . .] Dans la sphère commerciale, l'hégémonie pousse à la libéralisation et maintient un marché ouvert ; dans le domaine monétaire, elle fournit une monnaie internationale librement convertible, gère les taux de change, fournit des liquidités et sert de prêteur en dernier ressort ; et dans le domaine financier, il sert de source d'investissement international et de développement.
L'idée que l'acquisition agressive du marché par le capitalisme de copinage représente en quelque sorte les «marchés ouverts» de «l'économie mondiale capitaliste» est risible. Il est à peu près aussi éloigné du capitalisme de marché libre qu'il est possible de l'être. Sous le capitalisme de copinage, le dollar américain, en tant que monnaie de réserve mondiale préférée, n'est pas « librement convertible ». Les taux de change sont manipulés et la liquidité est une dette pour presque tout le monde sauf le prêteur. « Investissement et développement » par l'hégémon signifie plus de profits et de contrôle pour l'hégémon.
L'idée qu'un dirigeant politique, ou n'importe qui d'ailleurs, est entièrement mauvais ou bon, est puérile. La même considération peut être accordée aux États-nations, aux systèmes politiques ou même aux modèles d'ordre mondial. Le caractère d'un être humain, d'une nation ou d'un système de gouvernance mondiale est mieux jugé par l'ensemble de ses actions.
Tout ce que nous considérons comme la source du «bien» et du «mal», il existe en chacun de nous aux deux extrémités d'un spectre. Certaines personnes présentent des niveaux extrêmes de psychopathie, ce qui peut les amener à commettre des actes jugés « malfaisants ». Mais même Hitler, par exemple, a fait preuve de courage physique, de dévouement, de compassion pour certains et d'autres qualités que nous pourrions considérer comme « bonnes ».
Les États-nations et les structures de gouvernance mondiale, bien qu'immensément complexes, sont formés et dirigés par des personnes. Ils sont influencés par une multitude de forces. Compte tenu des complications supplémentaires du hasard et des événements imprévus, il est irréaliste de s'attendre à ce qu'une forme quelconque d'"ordre" soit entièrement bonne ou entièrement mauvaise.
Cela étant dit, si cet « ordre » est inique et cause un préjudice appréciable aux personnes, il est alors important d'identifier à qui cet « ordre » procure un avantage. Leur culpabilité individuelle et collective potentielle devrait faire l'objet d'une enquête.
Cela n'implique pas que ceux qui en profitent sont automatiquement coupables, ni qu'ils sont « mauvais » ou « mauvais », même s'ils peuvent l'être, mais seulement qu'ils ont un conflit d'intérêts à maintenir leur « ordre » malgré le mal qu'il cause. De même, lorsque le préjudice systémique est évident, il est irrationnel d'absoudre les actions des personnes qui dirigent et bénéficient de ce système sans d'abord exclure leur éventuelle culpabilité.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, des millions d'innocents ont été assassinés par les États-Unis, ses alliés internationaux et ses partenaires commerciaux, qui ont tous jeté leur poids militaire, économique et financier dans le monde. La « classe parasite » occidentale a cherché à affirmer son IRBO par tous les moyens nécessaires : sanctions, esclavage pour dettes ou esclavage pur et simple, guerre physique, économique ou psychologique. Le désir avide de plus de pouvoir et de contrôle a révélé le pire de la nature humaine. À plusieurs reprises et jusqu'à la nausée.
Bien sûr, la résistance à ce genre de tyrannie mondiale est compréhensible. La question est : l'imposition du modèle multipolaire offre-t-elle quelque chose de différent ?

Oligarchie
Plus récemment, « l'ordre mondial unipolaire » a été incarné par le Great Reset du Forum économique mondial . C'est tellement malin et rébarbatif que certains considèrent l'émergence de « l'ordre mondial multipolaire » comme le salut. Ils ont même fait l'éloge des dirigeants probables du nouveau monde multipolaire :
Il est [. . .] force de détermination et de caractère qui a défini les deux décennies de Poutine au pouvoir. [. . .] La Russie est engagée dans le processus de recherche de solutions pour tous ceux qui bénéficient de l'avenir, pas seulement quelques milliers d'oligarques plus saints que toi. [. . .] Ensemble [la Russie et la Chine] ont dit au WEF de remettre la Grande Réinitialisation dans le trou dans lequel elle avait été conçue. [. . .] Poutine a déclaré à Klaus Schwab et au WEF que toute leur idée de la Grande Réinitialisation est non seulement vouée à l'échec, mais va à l'encontre de tout ce que les dirigeants modernes devraient poursuivre.
Malheureusement, il semble que cet espoir soit également mal placé.
Alors que Poutine a beaucoup fait pour débarrasser la Russie des oligarques soutenus par la CIA et soutenus par l'Occident qui détruisaient systématiquement la Fédération de Russie dans les années 1990, ils ont ensuite été remplacés par une autre bande d'oligarques ayant des liens plus étroits avec le gouvernement russe actuel. Quelque chose que nous allons explorer dans la partie 3 .
Oui, il est certainement vrai que le gouvernement russe, dirigé par Poutine et son bloc au pouvoir, a amélioré les revenus et les opportunités de vie de la majorité des Russes. Le gouvernement de Poutine a également considérablement réduit la pauvreté chronique en Russie au cours des deux dernières décennies.
La richesse en Russie, mesurée comme la valeur marchande des actifs financiers et non financiers, est restée concentrée entre les mains des 1 % les plus riches de la population. Cette mise en commun de la richesse parmi le centile supérieur est elle-même stratifiée et est majoritairement détenue par les 1 % les plus riches du 1 %. Par exemple, en 2017, 56 % de la richesse russe était contrôlée par 1 % de la population. La pseudo-pandémie de 2020-2022 a particulièrement profité aux milliardaires russes - comme aux milliardaires de toutes les autres économies développées.
Selon le Credit Suisse Global Wealth Report 2021 , l'inégalité de richesse en Russie, mesurée à l'aide du coefficient de Gini , était de 87,8 en 2020. La seule autre grande économie avec une plus grande disparité entre les riches et le reste de la population était le Brésil. Juste derrière le Brésil et la Russie sur l'échelle des inégalités de richesse se trouvaient les États-Unis, dont le coefficient de Gini était de 85.
En termes de concentration des richesses cependant, la situation en Russie était de loin la pire. En 2020, les 1 % les plus riches détenaient 58,2 % de la richesse de la Russie. C'était plus de 8 points de pourcentage de plus que la concentration de la richesse au Brésil, et bien pire que la concentration de la richesse aux États-Unis, qui s'élevait à 35,2 % en 2020.
Une telle répartition disproportionnée des richesses est propice à la création et à l'autonomisation des oligarques. Mais la richesse seule ne détermine pas si l'on est un oligarque. La richesse doit être convertie en pouvoir politique pour que le terme « oligarque » soit applicable. Une oligarchie est définie comme « une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir suprême est confié à une petite classe exclusive ».
Les membres de cette classe dominante sont installés par une variété de mécanismes. L'establishment britannique, et en particulier sa classe politique, est dominé par des hommes et des femmes qui ont été éduqués à Eton, Roedean, Harrow et St. Pauls, etc. Cette « petite classe exclusive » constitue sans doute une oligarchie britannique. La nouvelle Premier ministre du Royaume-Uni, Liz Truss, a été annoncée par certains parce qu'elle n'est pas diplômée de l'une de ces écoles publiques sélectionnées.
Privilège éducatif mis à part, cependant, l'utilisation du mot «oligarque» en Occident fait plus communément référence à une classe internationaliste de mondialistes dont la richesse individuelle les distingue et qui utilisent cette richesse pour influencer les décisions politiques.
Bill Gates est un excellent exemple d'oligarque. L'ancien conseiller du Premier ministre britannique, Dominic Cummings, l'a dit lors de son témoignage devant une commission parlementaire en mai 2021 (aller à 14:02:35). Comme l'a dit Cummings, Bill Gates et "ce genre de réseau" avaient dirigé la réponse du gouvernement britannique à la supposée pandémie de COVID-19.
L'immense richesse de Gates lui a permis d'accéder directement au pouvoir politique au-delà des frontières nationales. Il n'a aucun mandat public ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni. C'est un oligarque, l'un des plus connus mais loin d'être le seul.
David Rothkopf, membre du CFR, a décrit ces personnes comme une "superclasse" avec la capacité "d'influencer régulièrement la vie de millions de personnes au-delà des frontières". Ils le font, a-t-il dit, en utilisant leurs « réseaux » mondialistes. Ces réseaux, tels que décrits par Antony C. Sutton, Dominic Cummings et d'autres, agissent comme « le multiplicateur de force dans tout type de structure de pouvoir ».
Cette « petite classe exclusive » utilise sa richesse pour contrôler les ressources et donc la politique. Les décisions politiques, les politiques, les décisions de justice et plus encore sont prises à leur demande. Ce point a été souligné dans la lettre conjointe envoyée par les procureurs généraux (AG) de 19 États américains au PDG de BlackRock, Larry Fink .
Les AG ont observé que BlackRock utilisait essentiellement sa stratégie d'investissement pour poursuivre un programme politique :
Les sénateurs élus par les citoyens de ce pays déterminent quels accords internationaux ont force de loi, pas BlackRock.
Leur lettre décrit le modèle théorique de la démocratie représentative. La démocratie représentative n'est pas une véritable démocratie - qui décentralise le pouvoir politique au citoyen individuel - mais plutôt un système conçu pour centraliser le contrôle et l'autorité politiques. Inévitablement, la «démocratie représentative» conduit à la consolidation du pouvoir entre les mains de la soi-disant «superclasse» décrite par Rothkopf.
Il n'y a rien de "super" à leur sujet. Ce sont des gens ordinaires qui ont acquis des richesses principalement par la conquête, l'usure, la manipulation du marché, la manipulation politique et l'esclavage. « Classe parasite » est une description plus appropriée.
Non seulement les sociétés d'investissement mondiales comme BlackRock, Vanguard et State Street utilisent leurs immenses ressources pour orienter la politique publique, mais leurs principaux actionnaires comprennent les mêmes oligarques qui, via leur contribution à divers groupes de réflexion, créent les agendas politiques mondiaux qui déterminent la politique dans le première place. Il n'y a pas de place dans ce système de prétendu « ordre mondial » pour un véritable contrôle démocratique.
Comme nous le verrons dans la partie 3 , les leviers de contrôle sont exercés pour obtenir exactement le même effet en Russie et en Chine. Les deux pays ont une bande d'oligarques dont les objectifs sont fermement alignés sur le programme de la Grande Réinitialisation du WEF. Eux aussi travaillent avec leurs « partenaires » gouvernementaux nationaux pour s'assurer qu'ils arrivent tous aux « bonnes » décisions politiques.

Le modèle de souveraineté nationale des Nations Unies
Tout bloc de nations qui tente de dominer les Nations Unies recherche l'hégémonie mondiale. L'ONU permet la gouvernance mondiale et centralise le pouvoir et l'autorité politiques mondiaux. Ce faisant, l'ONU renforce l'oligarchie internationale.
Comme indiqué précédemment, l'article 2 de la Charte des Nations Unies déclare que l'ONU est « fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres ». La Charte énumère ensuite les nombreuses façons dont les États-nations ne sont pas égaux. Il clarifie également comment ils sont tous soumis au Conseil de sécurité de l'ONU.
Malgré toutes les revendications de principes nobles de l'ONU - le respect de la souveraineté nationale et des prétendus droits de l'homme - l' article 2 déclare qu'aucun État-nation ne peut recevoir d'aide d'un autre tant que le Conseil de sécurité de l'ONU oblige cet État-nation à se conformer à ses édits. Même les États non membres doivent respecter la Charte, qu'ils le veuillent ou non, par décret des Nations Unies.
La Charte des Nations Unies est un paradoxe. L'article 2.7 affirme que « rien dans la Charte » n'autorise l'ONU à porter atteinte à la souveraineté d'un État-nation, sauf lorsqu'elle le fait par le biais de « mesures coercitives » de l'ONU. La Charte stipule, apparemment sans raison, que tous les États-nations sont « égaux ». Cependant, certains États-nations sont habilités par la Charte à être beaucoup plus égaux que d'autres.
Alors que l'Assemblée générale de l'ONU est censée être un forum décisionnel composé de nations souveraines "égales", l'article 11 ne donne à l'Assemblée générale que le pouvoir de discuter des "principes généraux de coopération". En d'autres termes, il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions importantes.
L'article 12 stipule que l'Assemblée générale ne peut régler les différends que sur instruction du Conseil de sécurité. La fonction la plus importante de l'ONU, « le maintien de la paix et de la sécurité internationales », ne peut être assurée que par le Conseil de sécurité. Ce que les autres membres de l'Assemblée générale pensent des décisions de « sécurité » mondiales du Conseil de sécurité n'a aucune pertinence pratique.
L'article 23 précise quels États-nations forment le Conseil de sécurité :
Le Conseil de sécurité est composé de quinze membres de l'Organisation des Nations Unies. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques [Fédération de Russie], le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. L'Assemblée générale élit dix autres Membres de l'Organisation des Nations Unies comme membres non permanents du Conseil de sécurité. [. . .] Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour un mandat de deux ans.
L'Assemblée générale est autorisée à élire des membres « non permanents » au Conseil de sécurité sur la base de critères stipulés par le Conseil de sécurité. Actuellement, les membres « non permanents » sont l'Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana, l'Inde, l'Irlande, le Kenya, le Mexique, la Norvège et les Émirats arabes unis.
L'article 24 proclame que le Conseil de sécurité a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » et que toutes les autres nations conviennent que « le Conseil de sécurité agit en leur nom ». Le Conseil de sécurité enquête et définit toutes les menaces alléguées et recommande les procédures et les ajustements pour le remède supposé. Le Conseil de sécurité dicte quelles mesures supplémentaires, telles que des sanctions ou le recours à la force militaire, doivent être prises contre tout État-nation qu'il considère comme un problème.
L'article 27 décrète qu'au moins 9 des 15 États membres doivent être d'accord pour qu'une résolution du Conseil de sécurité soit appliquée. Les 5 membres permanents doivent être d'accord et chacun dispose d'un droit de veto. Tout membre du Conseil de sécurité, y compris les membres permanents, est exclu du vote ou de l'usage de son veto s'il est partie au différend en question.
Les États membres de l'ONU, en vertu de leur adhésion à la Charte, doivent fournir des forces armées à la demande du Conseil de sécurité. Conformément à l'article 47, la planification militaire et les objectifs opérationnels relèvent de la compétence exclusive des membres permanents du Conseil de sécurité par l'intermédiaire de leur comité d'état-major exclusif. Si les membres permanents sont intéressés par l'opinion d'une autre nation « souveraine », ils lui demanderont d'en fournir une.
L'inégalité inhérente à la Charte ne saurait être plus claire. L'article 44 note que « lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force », sa seule obligation consultative vis-à-vis de l'ONU au sens large est de discuter de l'utilisation des forces armées d'un autre État membre lorsque le Conseil de sécurité a ordonné à cette nation de combattre. Pour un pays qui est actuellement membre du Conseil de sécurité, l'utilisation de ses forces armées par le Comité d'état-major est une condition préalable à l'adhésion au Conseil.
Le Secrétaire général de l'ONU, identifié comme le « chef de l'administration » dans la Charte, supervise le Secrétariat de l'ONU. Le Secrétariat commande, enquête et produit les rapports censés éclairer la prise de décision de l'ONU. Les membres du personnel du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire général. Le Secrétaire général est « nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité ».
En vertu de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité est donc nommé roi. Cet arrangement confère aux gouvernements de ses membres permanents – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis – une autorité supplémentaire considérable. Il n'y a rien d'égalitaire dans la Charte des Nations Unies.
La suggestion que la Charte des Nations Unies constitue une « défense » de la « souveraineté nationale » est ridicule. La Charte des Nations Unies est l'incarnation de la centralisation du pouvoir et de l'autorité mondiale.
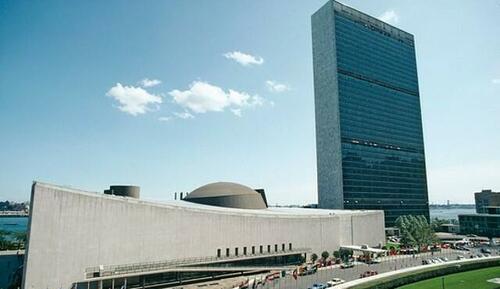
Le partenariat mondial public-privé des Nations Unies
L'ONU a été créée, dans une large mesure, grâce aux efforts de la Fondation Rockefeller (RF) du secteur privé . En particulier, le soutien financier et opérationnel complet du FR au Département économique, financier et de transit (EFTD) de la Société des Nations (LoN) et son influence considérable sur l'Administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction (UNRRA) ont fait du FR le acteur clé de la transformation de la LoN en ONU.
L'ONU est née d'un partenariat public-privé. Depuis lors, notamment en matière de défense, de financement, de santé mondiale et de développement durable, les partenariats public-privé sont devenus dominants au sein du système onusien. L'ONU n'est plus une organisation intergouvernementale, si elle en a jamais été une. Il s'agit d'une collaboration mondiale entre les gouvernements et un réseau infragouvernemental multinational de « parties prenantes » privées.
En 1998, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan , a déclaré au symposium de Davos du Forum économique mondial qu'une « révolution tranquille » s'était produite à l'ONU dans les années 1990 :
[L]es Nations Unies se sont transformées depuis notre dernière réunion ici à Davos. L'Organisation a subi une refonte complète que j'ai qualifiée de « révolution tranquille ». [. . .] [N]ous sommes mieux placés pour travailler avec les entreprises et l'industrie. [. . .] Les affaires des Nations Unies impliquent les affaires du monde. [. . .] Nous encourageons également le développement du secteur privé et l'investissement étranger direct. Nous aidons les pays à rejoindre le système commercial international et à promulguer une législation favorable aux entreprises.
En 2005, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), une agence spécialisée de l'ONU, a publié un rapport sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les soins de santé intitulé Connecting for Health . Parlant de la manière dont les « parties prenantes » pourraient introduire des solutions de soins de santé TIC à l'échelle mondiale, l'OMS a noté :
Les gouvernements peuvent créer un environnement favorable et investir dans l'équité, l'accès et l'innovation.
La conférence de 2015 sur le programme d'action d'Adis-Abeba sur le « financement du développement » a clarifié la nature d'un « environnement propice ». Les gouvernements nationaux de 193 États-nations des Nations Unies ont engagé leurs populations respectives à financer des partenariats public-privé pour le développement durable en convenant collectivement de créer « un environnement propice à tous les niveaux pour le développement durable » ; et « renforcer davantage le cadre de financement du développement durable ».
En 2017, la résolution 70/224 de l'Assemblée générale des Nations Unies (A/Res/70/224) a obligé les États membres de l'ONU à mettre en œuvre des « politiques concrètes » qui « permettent » le développement durable. A/Res/70/224 a ajouté que l'ONU :
[. . .] réaffirme la ferme volonté politique de relever le défi du financement et de la création d'un environnement propice à tous les niveaux pour le développement durable [—] en particulier en ce qui concerne le développement de partenariats en offrant de plus grandes opportunités au secteur privé, aux organisations non gouvernementales et à la société civile la société en général.
En bref, « l'environnement propice » est un engagement de financement du gouvernement, et donc des contribuables, pour créer des marchés pour le secteur privé. Au cours des dernières décennies, les secrétaires généraux successifs ont supervisé la transition officielle de l'ONU vers un partenariat mondial public-privé (G3P).
Les États-nations n'ont pas de souveraineté sur les partenariats public-privé. Le développement durable relègue formellement le gouvernement au rôle de partenaire « facilitateur » au sein d'un réseau mondial composé de sociétés multinationales, d'organisations non gouvernementales (ONG), d'organisations de la société civile et d'autres acteurs. Les « autres acteurs » sont principalement les fondations philanthropiques de milliardaires individuels et de dynasties familiales immensément riches, c'est-à-dire les oligarques.
Effectivement, alors, l'ONU sert les intérêts du capital. Non seulement il s'agit d'un mécanisme de centralisation de l'autorité politique mondiale, mais il s'engage à élaborer des programmes politiques mondiaux « favorables aux entreprises ». Cela signifie qu'il est adapté aux grandes entreprises. De tels programmes peuvent coïncider avec les meilleurs intérêts de l'humanité, mais s'ils ne le font pas, ce qui est largement le cas, eh bien, c'est tout simplement dommage pour l'humanité.
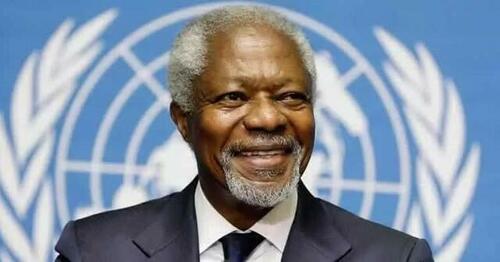
Gouvernance mondiale
Le 4 février 2022, un peu moins de trois semaines avant que la Russie ne lance son « opération militaire spéciale » en Ukraine, les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping ont publié une importante déclaration commune :
Les parties [Fédération de Russie et République populaire de Chine] soutiennent fermement le développement de la coopération et des échanges internationaux [. . .], participant activement au processus de gouvernance mondiale pertinent, [. . .] pour assurer un développement mondial durable. [. . .] La communauté internationale devrait s'engager activement dans la gouvernance mondiale[.] [. . .] Les parties ont réaffirmé leur intention de renforcer la coordination de la politique étrangère, de poursuivre un véritable multilatéralisme, de renforcer la coopération sur les plates-formes multilatérales, de défendre les intérêts communs, de soutenir l'équilibre international et régional des pouvoirs et d'améliorer la gouvernance mondiale. [. . .] Les parties appellent tous les États [. . .] pour protéger l'architecture internationale pilotée par l'ONU et l'ordre mondial fondé sur le droit international,
Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN-DESA) a défini la « gouvernance mondiale » dans sa publication de 2014 La gouvernance mondiale et les règles mondiales pour le développement dans l'ère post-2015 :
La gouvernance mondiale englobe la totalité des institutions, politiques, normes, procédures et initiatives par lesquelles les États et leurs citoyens tentent d'apporter plus de prévisibilité, de stabilité et d'ordre à leurs réponses aux défis transnationaux.
La gouvernance mondiale centralise le contrôle sur toute la sphère des relations internationales. Cela érode inévitablement la capacité d'une nation à définir sa politique étrangère. En tant que protection théorique contre l'instabilité mondiale, ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais en pratique, cela ne renforce ni ne « protège » la souveraineté nationale.
La domination du système de gouvernance mondiale par un groupe d'États-nations puissants représente peut-être la force la plus dangereuse et la plus déstabilisatrice de toutes. Cela permet à ces nations d'agir en toute impunité, indépendamment de toute prétention à respecter le prétendu « droit international ».
La gouvernance mondiale réduit également considérablement l'indépendance de la politique intérieure d'un État-nation. Par exemple, l' Agenda 21 pour le développement durable des Nations Unies, avec l' Agenda 2030 à court terme servant de point de repère, a un impact sur presque toutes les politiques nationales nationales - même en fixant le cap pour la plupart des politiques nationales - dans chaque pays.
La surveillance par les électeurs nationaux de cette « totalité » des politiques de l'ONU est faible, voire inexistante. La gouvernance mondiale fait de la soi-disant «démocratie représentative» un peu plus qu'une phrase vide de sens.
Comme l'ONU est un partenariat mondial public-privé (UN-G3P), la gouvernance mondiale permet au « partenariat multipartite » – et donc aux oligarques – une influence significative sur la politique intérieure et étrangère des États-nations membres. Dans ce contexte, le rapport UN-DESA (voir ci-dessus) fournit une évaluation franche de la véritable nature de la gouvernance mondiale UN-G3P :
Les approches actuelles de la gouvernance mondiale et des règles mondiales ont conduit à un plus grand rétrécissement de l'espace politique pour les gouvernements nationaux [. . . ] ; cela entrave également la réduction des inégalités au sein des pays. [. . .] La gouvernance mondiale est devenue un domaine avec de nombreux acteurs différents, notamment : les organisations multilatérales ; [. . .] des groupements multilatéraux d'élite tels que le Groupe des Huit (G8) et le Groupe des Vingt (G20) [et] différentes coalitions pertinentes pour des sujets politiques spécifiques [.] [. . .] Sont également incluses les activités du secteur privé (par exemple, le Pacte mondial), les organisations non gouvernementales (ONG) et les grandes fondations philanthropiques (par exemple, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Turner) et les fonds mondiaux associés pour résoudre des problèmes particuliers[. ] [. . .] La représentativité, les opportunités de participation, et la transparence de bon nombre des principaux acteurs sont sujettes à caution. [. . .] ONG [. . .] ont souvent des structures de gouvernance qui ne sont pas soumises à une responsabilité ouverte et démocratique. Le manque de représentativité, de responsabilité et de transparence des entreprises est d'autant plus important que les entreprises ont plus de pouvoir et promeuvent actuellement une gouvernance multipartite avec un rôle de premier plan pour le secteur privé. [. . .] À l'heure actuelle, il semble que les Nations Unies n'aient pas été en mesure d'orienter la solution des problèmes de gouvernance mondiale – manquant peut-être de ressources ou d'autorité appropriées, ou des deux. Les organes des Nations Unies, à l'exception du Conseil de sécurité, ne peuvent pas prendre de décisions contraignantes. ] ont souvent des structures de gouvernance qui ne sont pas soumises à une responsabilité ouverte et démocratique. Le manque de représentativité, de responsabilité et de transparence des entreprises est d'autant plus important que les entreprises ont plus de pouvoir et promeuvent actuellement une gouvernance multipartite avec un rôle de premier plan pour le secteur privé. [. . .] À l'heure actuelle, il semble que les Nations Unies n'aient pas été en mesure d'orienter la solution des problèmes de gouvernance mondiale – manquant peut-être de ressources ou d'autorité appropriées, ou des deux. Les organes des Nations Unies, à l'exception du Conseil de sécurité, ne peuvent pas prendre de décisions contraignantes. ] ont souvent des structures de gouvernance qui ne sont pas soumises à une responsabilité ouverte et démocratique. Le manque de représentativité, de responsabilité et de transparence des entreprises est d'autant plus important que les entreprises ont plus de pouvoir et promeuvent actuellement une gouvernance multipartite avec un rôle de premier plan pour le secteur privé. [. . .] À l'heure actuelle, il semble que les Nations Unies n'aient pas été en mesure d'orienter la solution des problèmes de gouvernance mondiale – manquant peut-être de ressources ou d'autorité appropriées, ou des deux. Les organes des Nations Unies, à l'exception du Conseil de sécurité, ne peuvent pas prendre de décisions contraignantes. la responsabilité et la transparence des entreprises sont d'autant plus importantes que les entreprises ont plus de pouvoir et promeuvent actuellement une gouvernance multipartite avec un rôle de premier plan pour le secteur privé. [. . .] À l'heure actuelle, il semble que les Nations Unies n'aient pas été en mesure d'orienter la solution des problèmes de gouvernance mondiale – manquant peut-être de ressources ou d'autorité appropriées, ou des deux. Les organes des Nations Unies, à l'exception du Conseil de sécurité, ne peuvent pas prendre de décisions contraignantes. la responsabilité et la transparence des entreprises sont d'autant plus importantes que les entreprises ont plus de pouvoir et promeuvent actuellement une gouvernance multipartite avec un rôle de premier plan pour le secteur privé. [. . .] À l'heure actuelle, il semble que les Nations Unies n'aient pas été en mesure d'orienter la solution des problèmes de gouvernance mondiale – manquant peut-être de ressources ou d'autorité appropriées, ou des deux. Les organes des Nations Unies, à l'exception du Conseil de sécurité, ne peuvent pas prendre de décisions contraignantes.
A/Res/73/254 déclare que le Bureau du Pacte mondial des Nations Unies joue un rôle vital dans « le renforcement de la capacité des Nations Unies à établir des partenariats stratégiques avec le secteur privé ». Il ajoute :
Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 reconnaît que la mise en œuvre du développement durable dépendra de l'engagement actif des secteurs public et privé[.]
Alors que les procureurs généraux de 19 États pourraient s'en prendre à BlackRock pour avoir usurpé l'autorité politique des sénateurs américains, BlackRock exerce simplement son pouvoir en tant que « partenaire public-privé » du gouvernement américain. Telle est la nature de la gouvernance mondiale. Étant donné que ce système a été construit au cours des 80 dernières années, il est un peu trop tard pour que 19 AG d'État s'en plaignent maintenant. Que font-ils depuis huit décennies ?
Les « partenaires » gouvernementaux de l'UN-G3P manquent d'« autorité » parce que l'ONU a été créée, en grande partie par les Rockefeller, comme un partenariat public-privé. La structure intergouvernementale est le partenaire du réseau infragouvernemental des acteurs privés. En termes de ressources, le pouvoir des « partenaires » du secteur privé éclipse celui de leurs homologues gouvernementaux.
Les fiefs des entreprises ne sont pas limités par les frontières nationales. BlackRock détient actuellement à lui seul 8,5 billions de dollars d' actifs sous gestion . C'est près de cinq fois la taille du PIB total de la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et plus de trois fois le PIB du Royaume-Uni.
Les pays dits souverains ne sont pas souverains sur leurs propres banques centrales ni « souverains » sur les institutions financières internationales comme le FMI, la Nouvelle Banque de développement (NDB), la Banque mondiale ou la Banque des règlements internationaux . L'idée que tout État-nation ou organisation intergouvernementale est capable de mettre au pas le réseau mondial du capital privé est farfelue.
Lors de la conférence COP26 à Glasgow en 2021, le roi Charles III - alors prince Charles - a préparé la conférence pour approuver l'annonce prochaine de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Il a clairement indiqué qui était responsable et, conformément aux objectifs de l'ONU, a clarifié le rôle des gouvernements nationaux en tant que « partenaires habilitants » :
L'ampleur et la portée de la menace à laquelle nous sommes confrontés appellent une solution au niveau des systèmes mondiaux basée sur une transformation radicale de notre économie actuelle basée sur les combustibles fossiles. [. . .] Mesdames et Messieurs, mon appel aujourd'hui est que les pays s'unissent pour créer l'environnement qui permet à chaque secteur de l'industrie de prendre les mesures nécessaires. Nous savons que cela prendra des billions, pas des milliards de dollars. [. . .] [N]ous avons besoin d'une vaste campagne de style militaire pour rassembler la force du secteur privé mondial, avec des billions à [sa] disposition bien au-delà du PIB mondial, et avec le plus grand respect, au-delà même des gouvernements des dirigeants du monde. Elle offre la seule véritable perspective de réaliser une transition économique fondamentale.
À moins que Poutine et Xi Jinping n'aient l'intention de restructurer complètement l'ONU, y compris toutes ses institutions et agences spécialisées, leur objectif de protéger "l'architecture internationale pilotée par l'ONU" semble n'être rien de plus qu'une tentative de consolider leur statut de dirigeants de l'ONU-G3P. Comme l'a souligné l'UN-DESA, par l'intermédiaire de l'UN-G3P, cette prétention à l'autorité politique est extrêmement limitée. Les entreprises mondiales dominent et consolident actuellement davantage leur pouvoir mondial grâce à la « gouvernance multipartite ».
Qu'il soit unipolaire ou multipolaire, le soi-disant « ordre mondial » est le système de gouvernance mondiale dirigé par le secteur privé – les oligarques. Les États-nations, dont la Russie et la Chine, ont déjà convenu de suivre les priorités mondiales déterminées au niveau de la gouvernance mondiale. La question n'est pas de savoir quel modèle d'« ordre mondial » mondial public-privé nous devrions accepter, mais plutôt pourquoi nous accepterions un tel « ordre mondial ».
Voilà donc le contexte dans lequel nous pouvons explorer les prétendus avantages d'un « ordre mondial multipolaire » dirigé par la Chine, la Russie et de plus en plus l'Inde. Est-ce une tentative, comme le prétendent certains, de revigorer les Nations Unies et de créer un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire